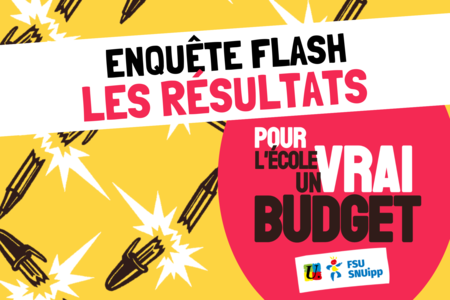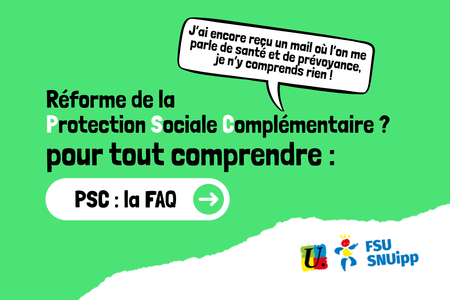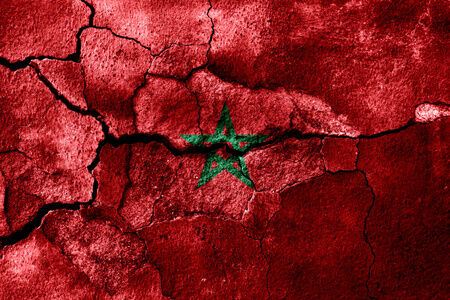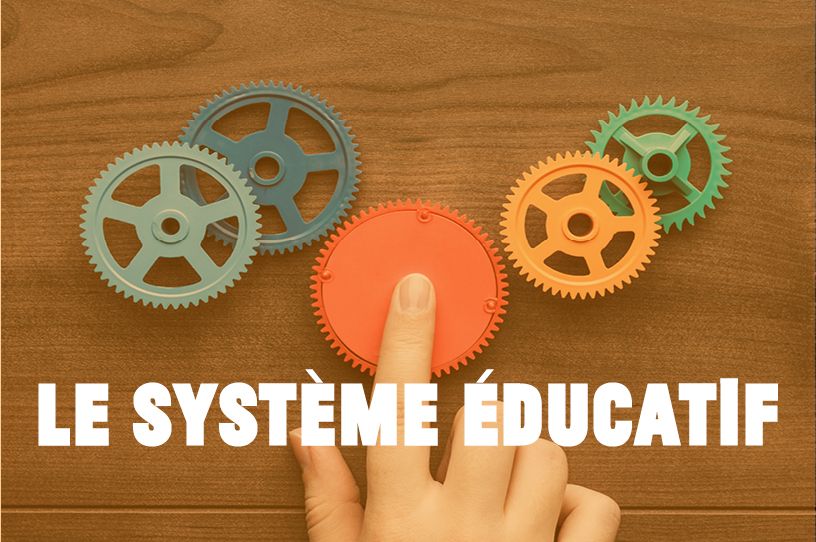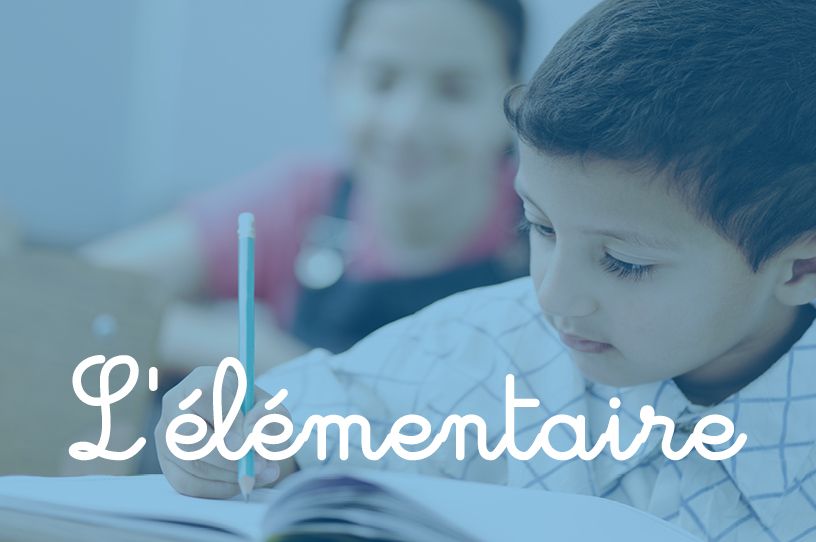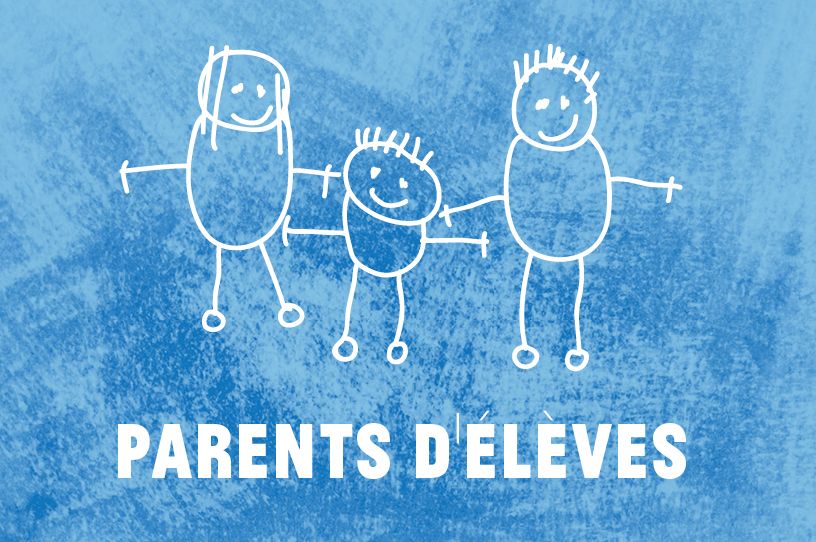Instaurer une dignité culturelle
Mis à jour le 20.03.25
min de lecture
Un exemple d'éveil à la diversité linguistique dans les Hautes-Pyrénées
Dans une école des Hautes-Pyrénées, l’éveil à la diversité linguistique est aussi une légitimation de chaque enfant et de sa famille.
« Bonjour, holà, jeje, buongiorno, hello, bonjou, përshëndetje, priviet, salam aleykum ». Chaque matin, les treize élèves de la GS de l’école tarbaise Jacques Prévert – nichée au cœur du quartier populaire de Laubadère – entonnent cette chanson d’accueil. Cette mélodie de bonjours multilingues a été construite au fil des mois, au fil des venues en classe des parents. « Il existe une croyance persistante qu’il ne faut pas parler sa langue pour s’intégrer à l’école, explique l’enseignante Édith Palyart. Il a fallu déconstruire cette représentation pour donner une place à la diversité linguistique et culturelle des enfants. ». Un travail patient et souple, la maîtrise inégale du français comme les écarts de représentations de l’école créant souvent un malaise des familles.
Édith a d’abord fait venir les parents socialement les plus en connivence avec le milieu scolaire, en leur demandant comment dire « bonjour » et compter jusqu’à cinq dans leur langue d’origine. Puis, sollicitées par les enfants eux-mêmes, toutes les familles sont venues, avec des participations diverses et des durées disparates. La mère d’Olivja présente une comptine albanaise, celle de Hayfa chante une berceuse en arabe soudanais, celle d’Isa décrit les paysages d’Azerbaïdjan, celles de Zayd et Ibrahim offrent thé et pâtisseries marocaines, celle de Naifal raconte l’histoire des Comores. Tous ces témoignages constituent un partage culturel supplémentaire. Le rap tunisien de la mère de Nassir a aussi marqué les esprits, participant à déconstruire une vision stéréotypée du pays.
DIMENSION MÉTALINGUISTIQUE
Chaque rencontre est immortalisée en photo. Arij est émue d’ajouter celle de sa mère qui parle hassaniya (langue sahraouie) et espagnol dans le tronc de l’arbre des langues où chaque bonjour est inscrit sur une feuille. « Cela fédère et donne à voir qu’il existe aussi divers systèmes graphiques et alphabétiques », précise l’enseignante. Mais l’essentiel porte sur la sensibilisation aux sonorités, tonicités et prosodies orales des langues. Édith pointe l’articulation de chaque nombre et la répétition patiente des parents. Elle se réjouit de la curiosité des élèves, de leur écoute attentive et de leur application à reproduire les sons et les accents des mots. « Ils commencent à faire des comparaisons, à percevoir des singularités », indique Édith qui a aussi fait participer son collègue occitan. « Entendre parler sa langue est source de fierté ».
Une fierté encore plus forte lorsque les élèves présentent les comptines numériques aux camarades de PS. « Yonn, dé, twa, kat, senk » récite Maëlya dont la mère explique combien parler créole constitue une réhabilitation de cette langue autrefois rejetée à l’école martiniquaise. De même le fait de parler en arabe, deuxième langue vivante parlée en France mais prise en charge marginalement par l’école publique, permet de lui redonner un statut. Pour Édith, « autoriser les parents à transmettre les parcours de vie et à restaurer la légitimité de leur langue d’origine est une reconnaissance nécessaire, c’est mettre sur un pied d’égalité les cultures comme les enfants. ».