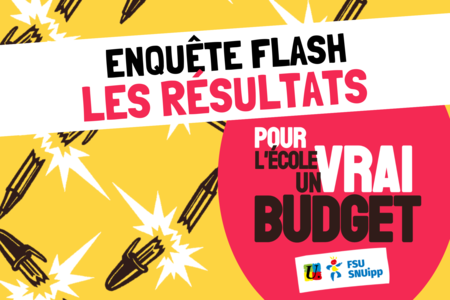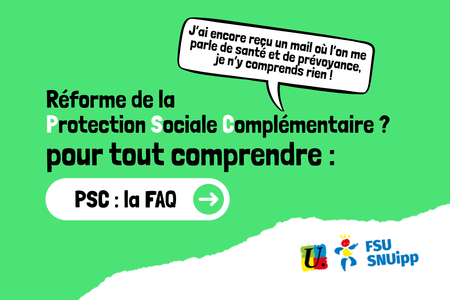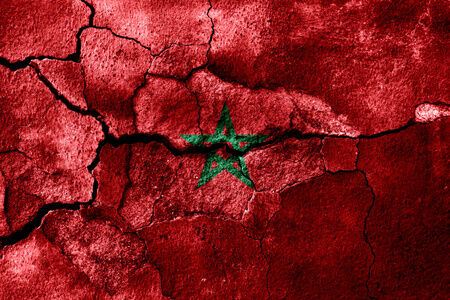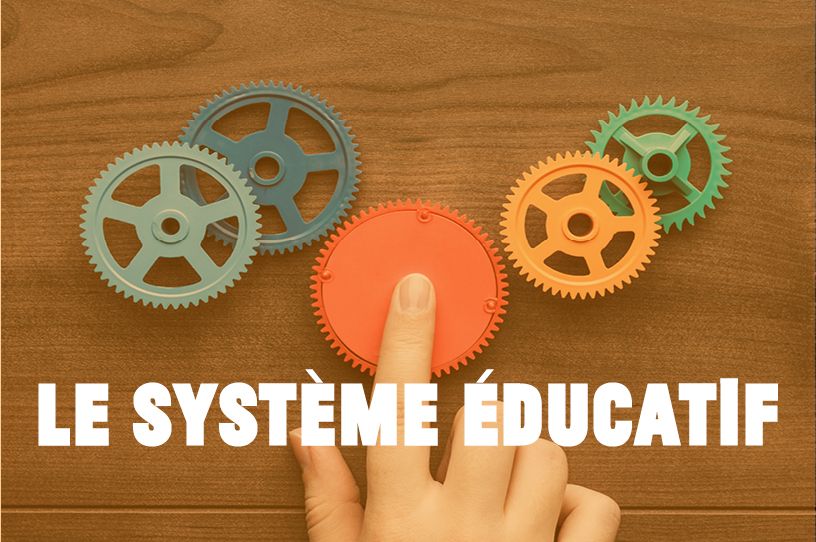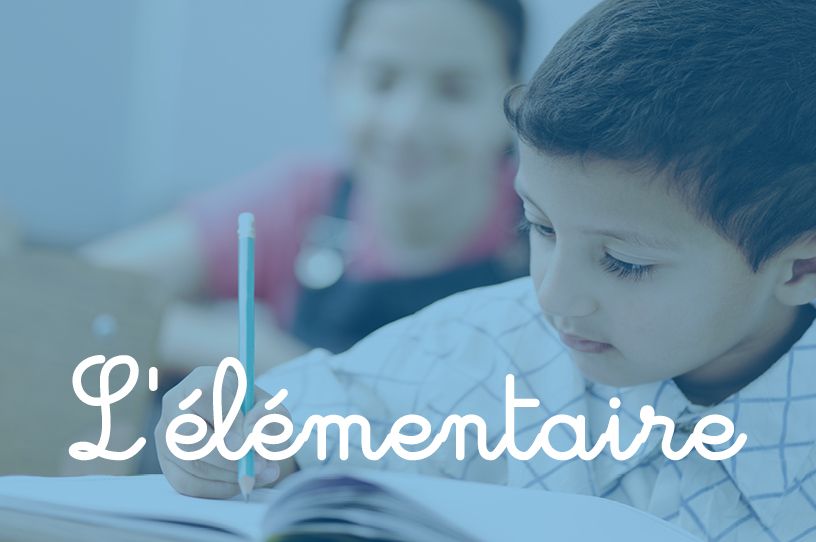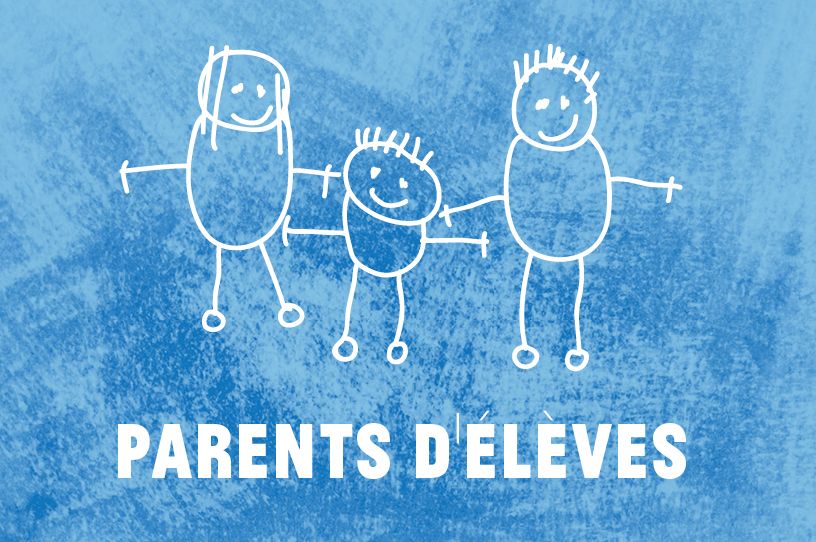La mémoire contre l’indifférence
Mis à jour le 21.03.25
min de lecture
Interroger le présent à la lecture du passé au camp des Milles
La visite du Site-Mémorial du camp des Milles à Aix-en-Provence conduit les CM1-CM2 de l’école Roumanille à interroger le présent à la lecture du passé.
Au pied de la montagne Sainte-Victoire, majestueuse dentelle calcaire immortalisée par Cézanne, s’élèvent les murs de brique rouge du camp des Milles, à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Cette usine reconvertie en camp d’internement puis de déportation entre 1939 et 1942 fait partie du cadre de vie des CM1-CM2 de l’école Roumanille. Selon Geneviève Lerique, leur enseignante, son passé funèbre « suscite la curiosité des élèves qui confine parfois à l’angoisse : « Comment des hommes ont-ils pu infliger cela à d’autres hommes? ».
À ce besoin de comprendre répond le partenariat engagé avec Blandine Maillet, chargée de mission du service éducatif du Site-Mémorial. L’objectif d’éclairer le présent par le passé local donne sa cohérence au travail interdisciplinaire engagé au cours de l’année scolaire. De la participation à la commémoration du 80e anniversaire de la libération d’Auschwitz, Raphaël a retenu qu’il faut « se rappeler des mauvais traitements » subis par les internés car « se souvenir permet de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé » poursuit Alexandra.
Avant de parcourir les intérieurs sombres, froids et à l’air autrefois saturé de poussière d’argile, les élèves étudient des œuvres de Max Ernst, Hans Bellmer, Ferdinand Springer et Wols, artistes allemands fuyant le nazisme et pourtant internés aux Milles dès 1939. Peintures et gravures expriment la dureté de la détention. Bianca comprend « la tristesse de la séparation » d’avec l’être aimé. Raphaël réalise « qu’ils dormaient à même le sol avec une simple couverture ». Roy s’émeut de l’injustice qui leur est faite « Pourquoi ne pas appeler la police au secours ? ». Sans doute « parce qu’elle collaborait avec les nazis » suggère Malo, citant « Un sac de billes ».
L’ART, FORME DE RÉSISTANCE
À travers les tableaux, transparaissent la solitude, le froid, la faim, le manque d’hygiène et d’intimité, l’horizon partout obstrué par les briques, la mort qui rode… Mais ces funestes révélations ne sont pas dénuées d’espoir car Marius y voit « des traces de ce qu’ils ont vécu pour qu’on ne le refasse plus ». L’art pour survivre inviterait ainsi au refus de l'indifférence et à la résistance. Une intuition confirmée par la découverte sur site de l’improbable reproduction du cabaret berlinois « Die Katakombe » au cœur des fours désaffectés de l’usine-camp.
« En évitant l’écueil du sensationnel et avec la conscience qu’il est bien difficile de lutter contre des représentations familiales qui peuvent véhiculer la peur de l’étranger », Geneviève se félicite que l’exploration du camp des Milles constitue un point d’appui pour le vivre ensemble et le respect des différences dans une école où un quart des élèves sont issus de familles Rom ou du voyage. « Les élèves prennent conscience que juger arbitrairement autrui peut conduire aux drames du camp des Milles. Leur façon de se comporter les uns avec les autres changent. Ils s’écoutent davantage avec empathie, collaborent de manière plus responsable. C’est encourageant même si on sait qu’on ne fait que semer des graines… ».