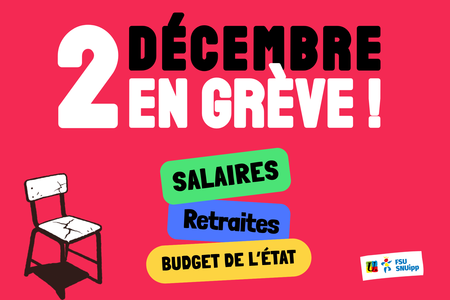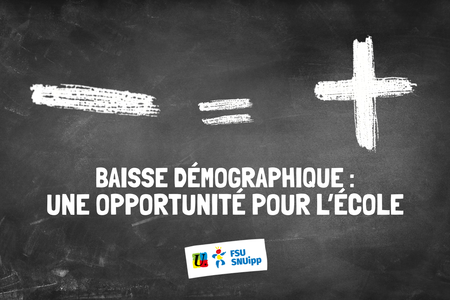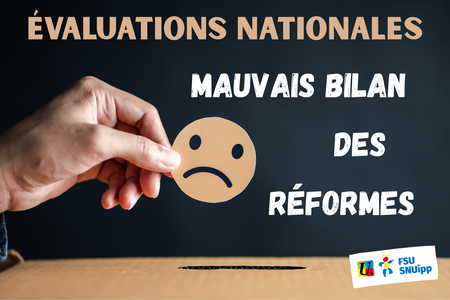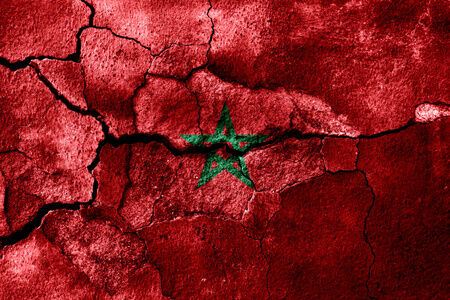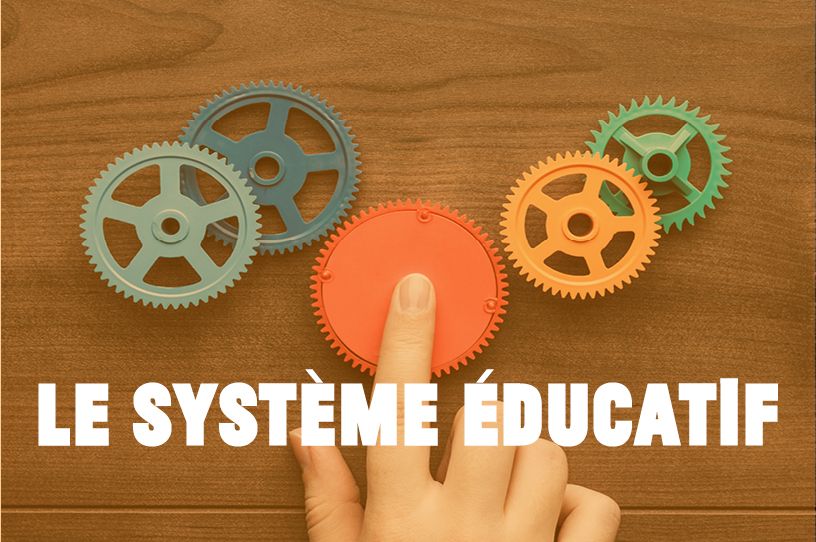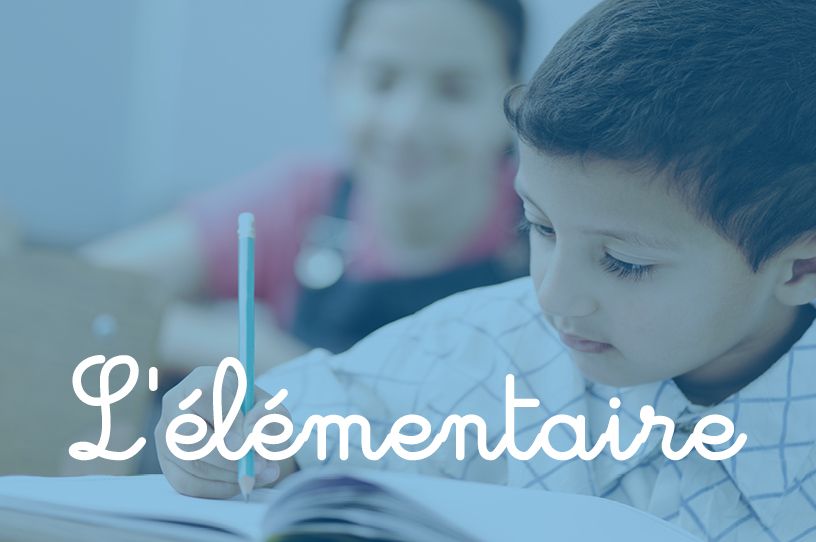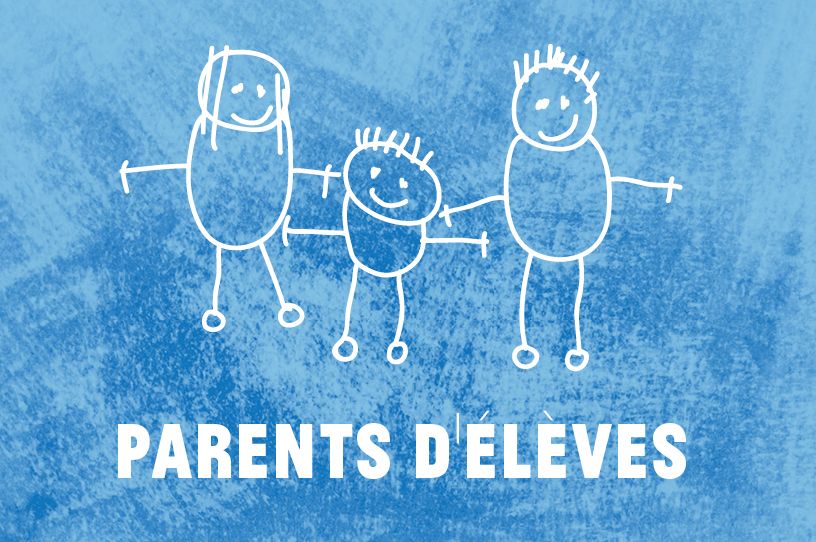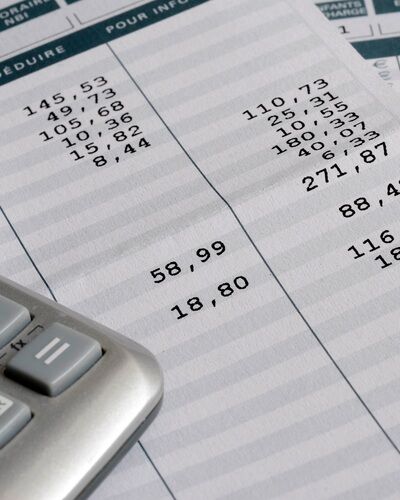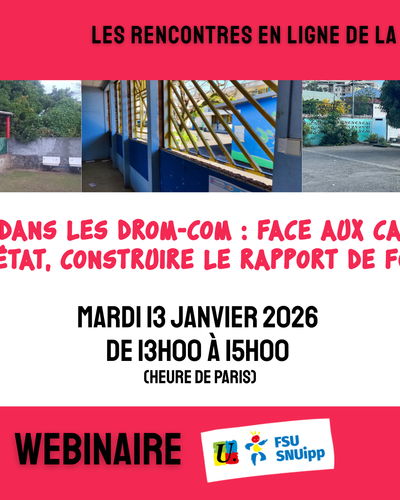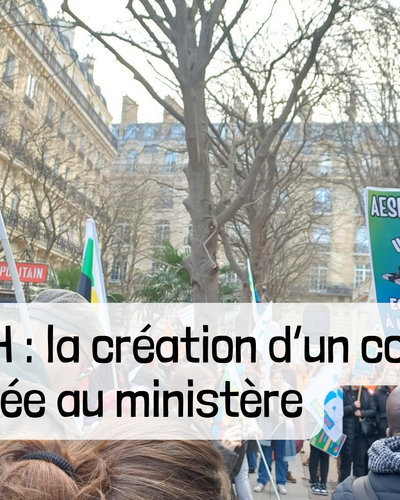S'exercer à l'esprit critique
Mis à jour le 25.11.22
min de lecture
L'esprit critique et sa place à l'école : Une démarche empirique et rationnelle
Filippo Pirone est maître de conférences en sciences de l'éducation - Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes du Politique Hannah Arendt - Université Paris Est Créteil - INSPE de l'Académie de Créteil

Comment définir l'esprit critique et sa place à l'école ?
L’esprit critique est une compétence basée sur la rationalité qui permet aux individus d’évaluer leurs croyances et celles des autres grâce à des outils, des normes et des procédures rationnelles. Bien que centrale, elle est encore marginalisée à l’école et balbutiante dans les curricula scolaires. Dans des sociétés ouvertes et rationnelles basées sur la maîtrise de l’esprit critique comme les nôtres, c’est un paradoxe. Par rapport aux pays anglo-saxons et d’Europe du Nord, l’esprit critique est apparu assez tardivement dans les programmes scolaires français. Il a fallu attendre les programmes de 1978 pour que le terme « attitude critique » soit mentionné dans les programmes de 3e. Au cours des quarante dernières années, cette compétence ne s’est pas développée de manière formalisée dans les curricula et les occurrences dans les programmes sont encore peu nombreuses.
Quels constats issus de vos recherches en classe ?
J’ai surtout travaillé dans des classes investies dans un dispositif particulier « Savanturiers - École de la recherche », qui a comme objectif d’initier les élèves aux approches scientifiques. On observe que la manière dont on travaille l’esprit critique reste fluctuante y compris chez ces enseignants qui sont plus familiers que d’autres de cette compétence-là. Les élèves observés semblent très à même d’expliquer le contenu des activités, des apprentissages avec une capacité de « feed-back » ou retours sur information plus importante que ce qui peut s’observer habituellement. Du côté des enseignants, la gestion du groupe n’est pas évidente, les élèves étant souvent placés en autonomie ou en semi-autonomie : le travail sur la recherche collaborative des solutions nécessite des échanges et des débats avec une prise en compte et une analyse des arguments des autres. On constate une très grande participation des élèves avec une plus ou moins grande aisance à l’oral selon leur milieu d’origine. Des différences genrées apparaissent aussi, la place occupée par les garçons étant très nettement plus importante que celle occupée par les filles. Malgré les difficultés, on observe tout de même une participation assez enthousiaste des classes impliquées dans ce genre d’activités.
Des pistes pour développer l'esprit critique ?
Dans la diversité des contextes de classe et des styles d’enseignants, on peut dégager des traits communs : l’importance de travailler des compétences transversales, comme l’auto-contrainte et l’autonomie scolaire, de faire respecter la parole des autres. Faire participer tout le monde sans que personne ne prenne le dessus sur les autres, s’écouter de manière constructive devrait faire l’objet d’un apprentissage en soi. Les enseignants doivent aussi faire évoluer leur propre rôle dans le sens d’un accompagnement des élèves dans leur raisonnement en renonçant temporairement à une autorité un peu verticale dans laquelle il n’y a qu’une vérité, qu’une manière de mener à bien le raisonnement. Le fait non seulement de ne pas punir l’erreur, mais aussi de s’y appuyer pour en faire un levier pédagogique, apparaît un atout majeur. En outre, ce dispositif montre l’intérêt de la démarche scientifique dans les apprentissages et dans les enseignements. L’élève cherche l’information, émet des hypothèses, les teste. Il se pose des questions, observe. C’est une démarche empirique et rationnelle. Pour la mettre en place dans les classes, il faudrait se donner les moyens en formation enseignante, pas seulement initiale, ce qui n’est pas le cas en France.
En quoi est-ce un enjeu de démocratisation scolaire ?
Il faut rappeler l’importance de la pédagogie explicite, notamment pour les élèves de milieu populaire. Être dans une démarche d’auto-construction dans un cadre moins rigide ne veut pas dire que tout soit brouillé ou dissimulé. Si on veut entrer de manière moins abstraite dans les contenus d’enseignement, le travail sur le « feed-back » est aussi un levier essentiel. L’importance de l’esprit critique n’est pas nouvelle. Il y a plus de 100 ans, Durkheim promouvait un système scolaire basé sur l’apport des sciences. Il y défendait le double objectif de former le citoyen de demain, responsable et pouvant participer à la chose commune de manière active et solidaire et de construire un individu émancipé qui peut raisonner par lui-même, qui ne se laisse pas soumettre aux différentes emprises et à la pensée unique. Ces nécessités-là ne sont pas nouvelles mais on se rend compte qu’elles restent tout aussi importantes à notre époque.