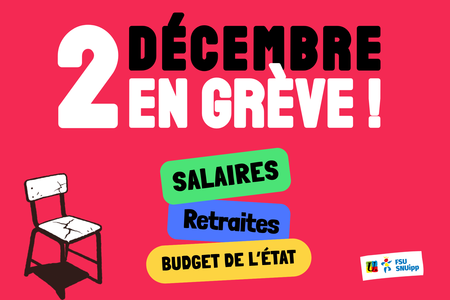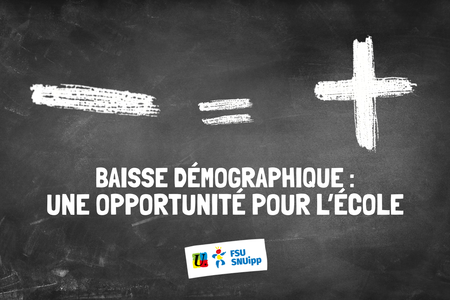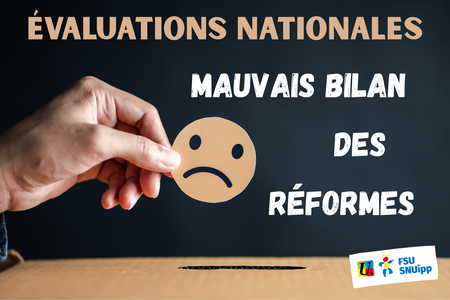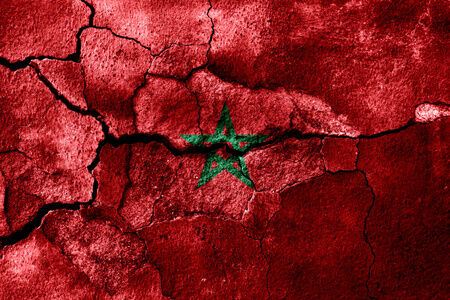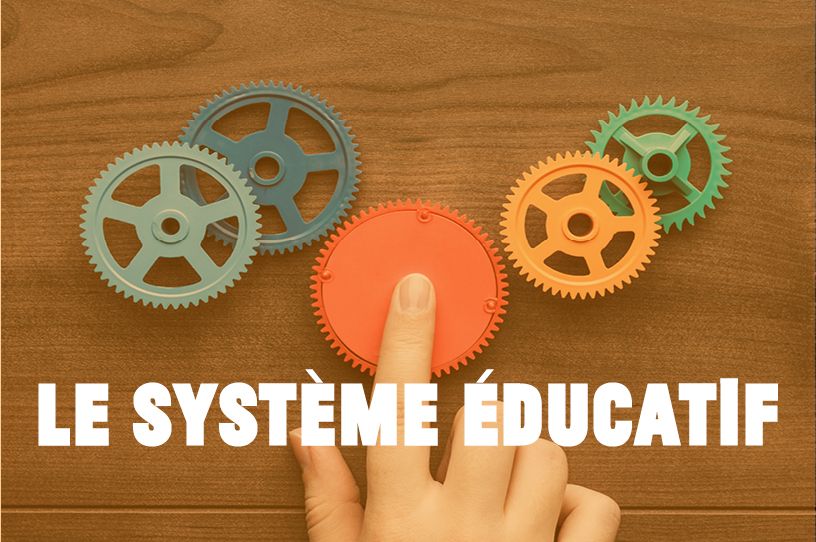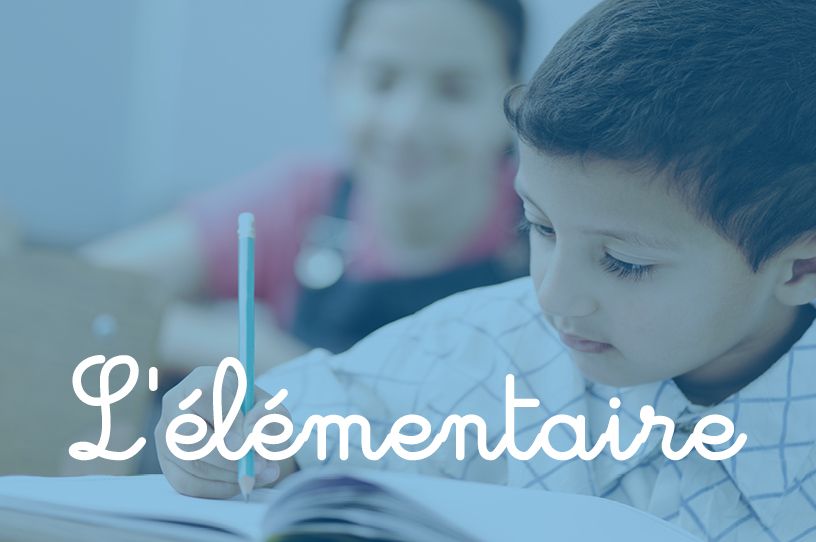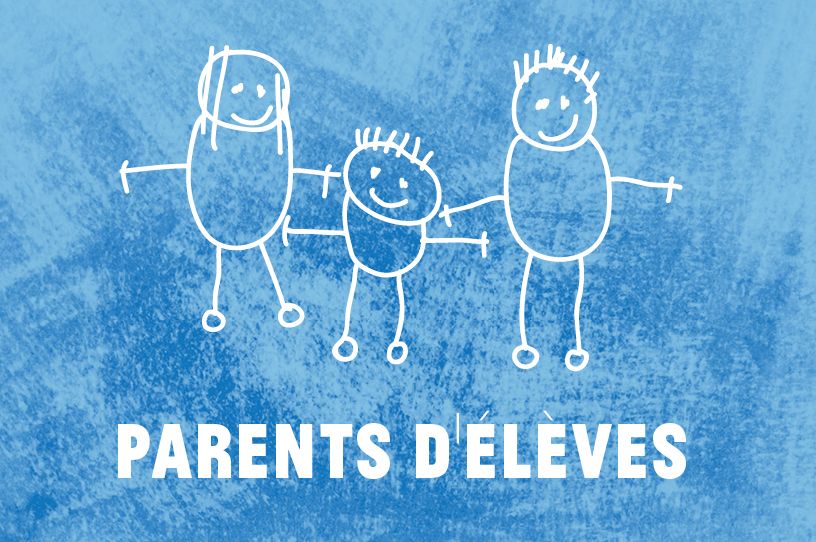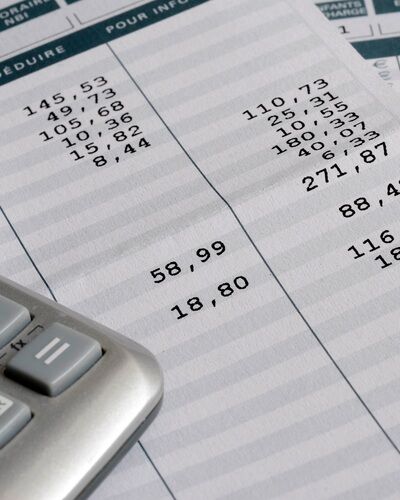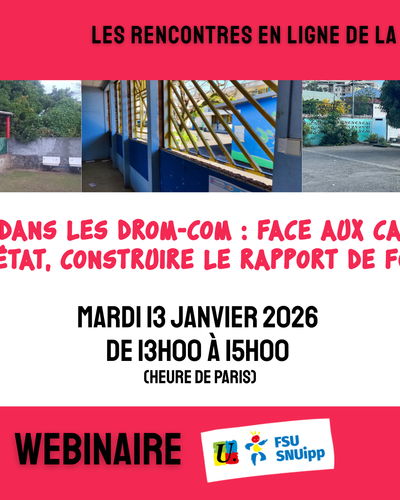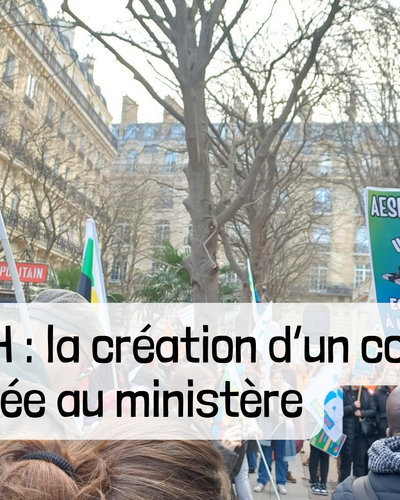Ecrire, écrire, écrire...
Mis à jour le 26.11.22
min de lecture
"Avec l'écrit, je produis une pensée aboutie" : Danielle Alexandre parle de l'écriture comme d'une urgence démocratique, un lien avec le développement de la pensée critique.
Danielle Alexandre est agrégée de lettres modernes. Elle a toujours conjugué la pratique effective du métier d'enseignant (de la maternelle à l'université) et la confrontation aux travaux de recherche en sciences de l'éducation. Elle s'est particulièrement intéressée aux exigences de l'écriture dans toutes les disciplines.

En quoi l'écriture à l'école relève de l'urgence démocratique ?
On assiste dans la société à une accélération de l’évolution des modes d’expression écrite. Les réseaux sociaux sont envahis de formes d’écrits bruts, sans filtre et sans distance, centrés sur le ressenti émotionnel. Ces lieux d’expression sont désertés par ceux qui développent une pensée critique et argumentée et dont la voix est de plus en plus inaudible. L’école devient le seul lieu où l’on peut développer une pensée exigeante dans un cadre sécure. Or les pratiques mises en œuvre à l’école restent dominées par un modèle que j’oserais qualifier d’archaïque, le modèle de la rédaction avec peu, voire pas du tout, de place pour des écrits à visée réflexive. Globalement, les activités d’écriture sont trop rares, conçues comme un travail chronophage souvent mal vécu qui demande énormément d’investissement aux élèves comme aux enseignants. L’idée est de développer, à l’opposé, des pratiques faisables, dédramatisées, insérées dans le travail quotidien, permettant aux élèves d’appréhender le monde dans sa complexité. Si l’école ne remplit pas suffisamment ce rôle, il ne restera bientôt plus qu’une élite qui maîtrisera vraiment l’écrit à l’opposé d’un idéal républicain. Tout ce travail relève donc de l’exigence démocratique.
Quel lien faites-vous entre l'écriture de textes et le développement de la pensée critique ?
Une idée tenace contre laquelle je m’élève est que cette préoccupation ne concerne pas l’école primaire. J’insiste, les enfants pensent et ils pensent dès le cycle 1. À l’oral, je peux ne pas terminer mes phrases, jeter des bribes de pensée, revenir dessus... Avec l’écrit, je produis une pensée aboutie et ce travail-là, on ne le fait nulle part ailleurs. Vigotsky en 1932 dans « Langage et pensée » l’avait déjà bien montré : quand je suis dans l’appréhension directe du monde, je saisis toutes sortes d’informations, des flashes de pensée se télescopent où ordre et hiérarchie sont aléatoires. Lorsque je les mets par écrit, j’entre dans un modèle linéaire, celui de la phrase avec une obligation de mise en ordre, de mise en cohérence linguistique qui sont redoutablement exigeants. Pour faire évoluer les écrits, on aura besoin de l’oral mais l’écrit reste l’outil le plus puissant pour organiser sa pensée et donc comprendre le monde.
Quelle place donner à l'écriture dans l'ensemble des apprentissages ?
C’est d’abord favoriser l’écriture dans toutes les disciplines ou activités et dans le travail quotidien de la classe. On va écrire pour organiser sa pensée, s’approprier véritablement les savoirs. On apprend aussi à adopter consciemment des points de vue différents pour se préparer aux approches disciplinaires rigoureuses attendues dans le secondaire. Chaque discipline a des formes d’écriture spécifiques qui sont rarement explicitées. Le plus souvent, les élèves doivent découvrir seuls comment on écrit l’histoire, la biologie ou plus tard la philo. Quand on fait des maths, on écrit maths même à l’école primaire et on doit savoir qu’on écrit maths. Chaque logique disciplinaire est très forte et seule la variation des approches va permettre de devenir un individu capable d’appréhender le monde selon plusieurs facettes, d’identifier le point de vue de celui qui s’exprime et ne pas croire sans distance n’importe quel gourou ou influenceur.
Quelles pistes proposez-vous pour aider les PE à enseigner l'écriture à l'école ?
Il faut dédramatiser les activités d’écriture et rassurer les enseignants. Arrêtons de penser qu’il faut être un spécialiste de la linguistique et du français pour faire progresser les élèves. La première piste est quantitative : il faut faire écrire les élèves très souvent. On se libère du modèle de la rédaction pour proposer des temps d’écriture qui s’insèrent dans toutes les activités de la classe et qui sont gérables. Cela implique qu’il faut s’appuyer sur le collectif de la classe, sortir du scénario individualiste de la pratique d’écriture solitaire soumis au seul regard des professeurs. L’écriture conçue ainsi ne passe plus exclusivement par l’enseignant expert qui supervise tous les écrits. Cela ne signifie pas qu’on écrit tout et n’importe quoi mais on passe par une régulation par les pairs. Dans ce scénario, le collectif de pairs se forme en travaillant les écrits des autres. Et pour les enseignant•es, il faut absolument des espaces où eux aussi peuvent réfléchir ensemble entre pairs.