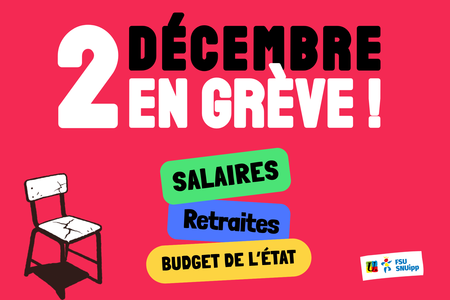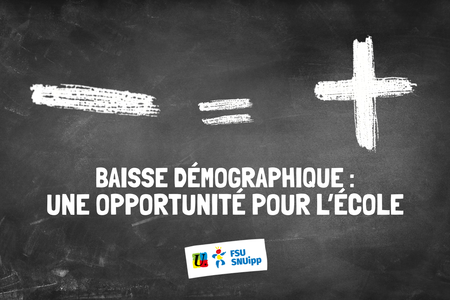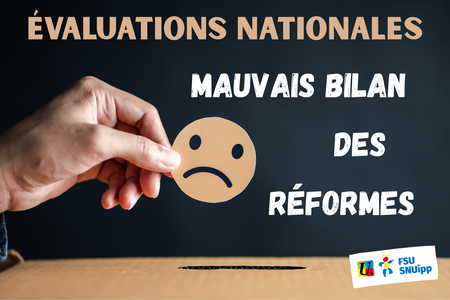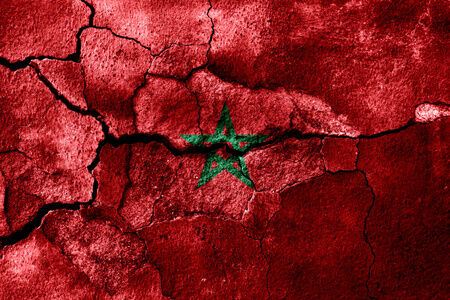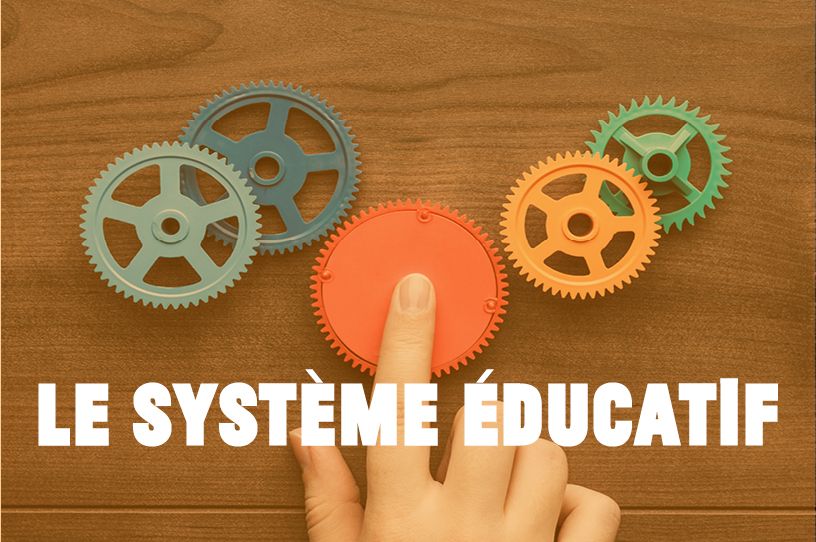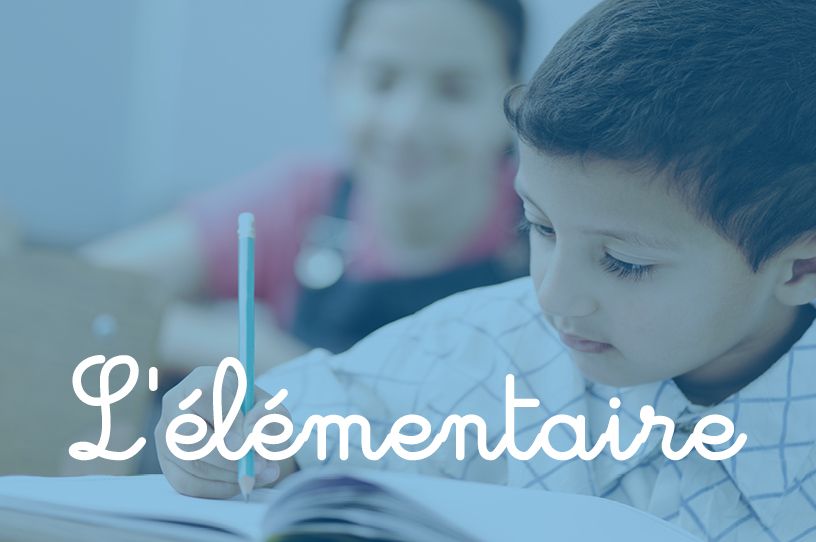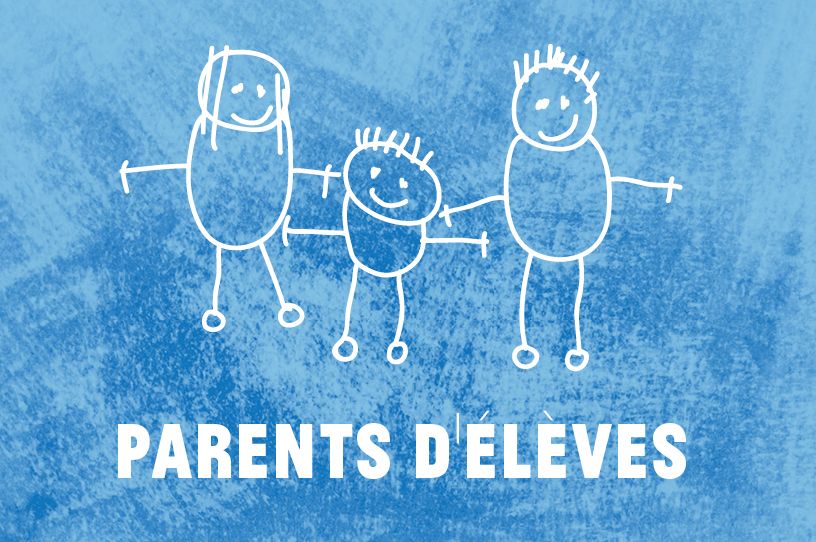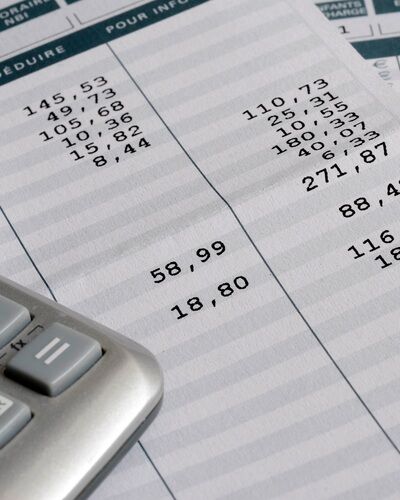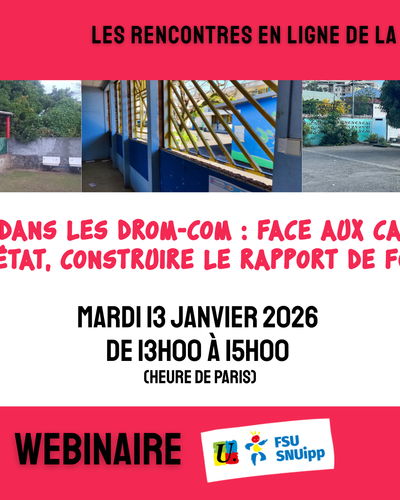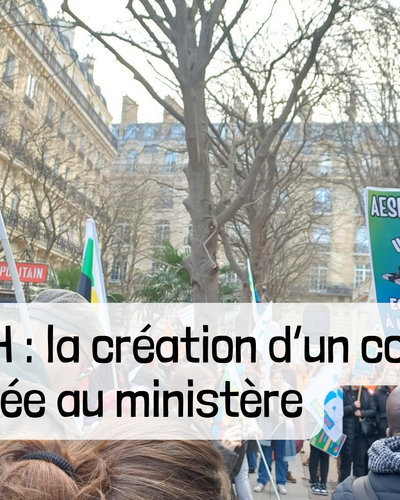Maternelle : langage
Mis à jour le 23.10.22
min de lecture
FsC 485 spécial Maternelle : Véronique Boiron interroge la place du langage, priorité absolue en maternelle. En remplaçant langage par langue, les nouvelles instructions de 2021 changent la donne. Pourtant le langage joue un rôle essentiel dans la construction de l'enfant et de l'élève. Les pratiques enseignantes doivent proposer des situations qui l'engagent fortement.
Véronique Boiron est didacticienne du français, enseignante chercheuse à l'INSPE de Bordeaux

Faut-il opposer "langue" et "langage" dans les apprentissages ?
Il ne faudrait ni les opposer ni considérer que la langue est prioritaire par rapport au langage. C'est parce qu'un enfant parle dans une situation proposée par le PE, qui l’intéresse et qu’il comprend, qu'il apprend à mobiliser la langue de l'école. Grâce aux reformulations, aux propositions syntaxiques et lexicales du PE, il développe simultanément des habiletés en langue et en langage. Les apports lexicaux sont proposés et mobilisés en contexte pour qu'ils aient du sens et qu'ils répondent à l'exigence de la situation. On sait que l'acquisition de certaines structures syntaxiques est liée au développement de l'enfant et prend du temps. Il est inutile de demander aux PE de mettre en œuvre des tâches de répétition de mots ou de structures car les élèves mémorisent ces derniers uniquement dans une situation qui a du sens, dans le contexte d’un jeu, d’une expérience et d’une recherche qui correspondent à leurs questionnements, à leurs besoins.
Les priorités actuelles semblent avoir été déplacées, qu'en est-il réellement ?
Le programme de 2015 a su mettre en avant le langage mais les modifications apportées en 2021 remplacent souvent « langage » par « langue ». Telle que la langue est présentée elle pourrait devenir un objet d’enseignement, sous forme de micro tâches juxtaposables... alors que la recherche montre qu’on n’apprend pas à parler à partir d’unités séparées. En maternelle, les enfants apprennent à parler dans le cadre des relations avec les personnes (PE, pairs, Atsem...) avec qui ils mènent une action, une activité : des jeux et des expérimentations, des activités de découverte, d’observation, des lectures, des catégorisations... L’enfant n’apprend pas à parler en apprenant une liste de mots ou des structures syntaxiques mais en parlant avec autrui à propos de ce qu’il observe, fait puis en expliquant à la classe ce qui s’est passé. Les situations signifiantes sont porteuses d’un vocabulaire spécifique et de structures variées qui correspondent et qui seront ensuite proposées dans d’autres contextes.
“Pour tous les élèves mais plus particulièrement pour ceux parlant peu, le petit groupe est à privilégier.”
Pour l'enfant, quel rôle joue le langage dans son passage au statut de sujet apprenant ?
Le langage permet aux enfants de dire d'abord ce qu'ils font puis ce qu'ils savent, ce qu'ils comprennent. Les PE leur demandent sans cesse d’expliquer, de reformuler, de préciser, d’expliciter des stratégies. Ce faisant, les élèves apprennent peu à peu à verbaliser, à questionner, à échanger des constats, des explications, des points de vue : ils sont alors en langage et mobilisent de nouveaux faits de langue. C'est dans les interactions orales avec le PE, les pairs, qu'ils se constituent et se reconnaissent en tant que sujets apprenants grâce à la langue commune de l'école. En maternelle, les PE aident les enfants à apprendre, de manière progressive, des
usages du langage qui mobilisent souvent un rapport intellectualisé, réflexif au monde.
Quels liens entre les différents langages : verbal, corporel, pictural, scientifique... ?
On ne parle pas d’une expérience ou d’une observation scientifique d'une construction comme d'un album ou d’une œuvre d’art. L'enfant apprend peu à peu à utiliser des outils langagiers adaptés et la médiation langagière du PE lui permet de s’approprier des pratiques langagières propres aux domaines scientifique, mathématique, littéraire, artistique. Il apprend alors à parler mathématique, littérature... Le langage corporel ou pictural joue un rôle fondamental et complémentaire car il permet d’expérimenter de nouvelles façons de signifier, de nouveaux codes, une symbolique autre.
Quelles sont les pratiques susceptibles de contribuer à la réduction des inégalités ?
Le langage reste la priorité absolue en maternelle et pour que les progrès langagiers se réalisent pour tous, il est nécessaire de proposer des situations qui engagent au langage. Pour tous les élèves mais plus particulièrement pour ceux parlant peu, le petit groupe est à privilégier. Par exemple en petite section, une activité « pâte à modeler » organisée sur une semaine avec un groupe
de trois élèves permet au PE de « parler » l'activité en commentant ce que ces élèves font, en employant un vocabulaire précis, en incitant à mener ou renouveler telle action, en explicitant les étapes... Au cours de la semaine, la consigne donnée à ces trois élèves est légèrement complexifiée de manière à ce que les enfants saisissent les attentes tout en reprenant à leur compte et en employant le vocabulaire et les structures proposés à plusieurs reprises par le PE.